Et pourtant, souffrent-elles? And yet, they suffer?- The Feral

(Metzinger, Lyotard, Meillassoux)
Dans Si l’on peut penser sans corps, daté de 1986 et ouvrant L’inhumain, Jean-François Lyotard critique avec une surprenante anticipation, le transhumanisme, par la mise en scène d’un différend sexuel. Le texte est articulé autour de deux personnages, lui et elle, qui se répondent et dont le différend semble faire écho à celui entre l’humain et la machine.
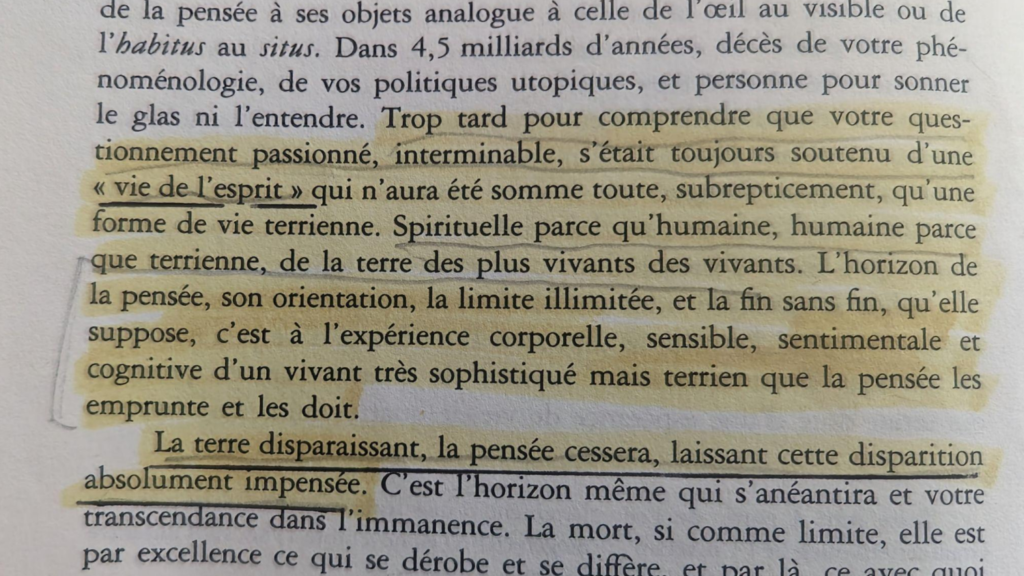
La séparation entre un hardware corporel et un software psychique qui permettrait au second de survivre au premier, est réfutable parce que la pensée, en tant que procès interminable, serait souffrance. Elle se résout à être en souffrance, c.-à-d. en français, à manquer de quelque chose et peut être d’elle-même, une pauvreté (pénia) avant toute perte. Il s’agit de la capacité d’être passible selon une ouverture qui n’est pas prédéterminée. Le non-encore-pensé y insiste et fait mal, comme après-coup qui a toujours été donné, souffrance d’avant toute blessure que Lyotard nomme enfance.
La séparation transhumaniste entre la pensée et le corps, qui est un dualisme assez (peut être trop) classique (pour être crédible), espère sauver la première infiniment de la corruption du corps et occulte que la pensée est déterminée par une localisation : la Terre en tant que la vie sur celle-ci dépend du soleil qui disparaîtra dans 4,5 milliards d’année. La finitude de la pensée n’est plus seulement à entendre comme l’histoire d’une subjectivité, mais également comme une histoire cosmique. La pensée n’aura été qu’un morceau temporaire de ce coin de la galaxie.
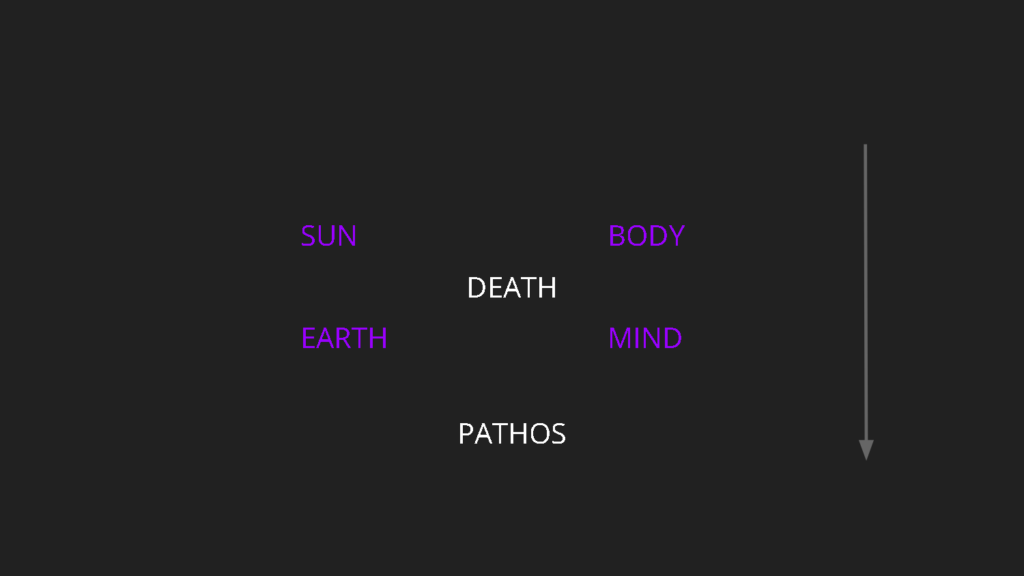
Si elle se doit de témoigner du timbre secret de l’enfance, de cette souffrance sans origine qui l’infonde, dans la dernière phrase du dernier texte de L’inhumain, Domus et la mégapole, Lyotard ajoute, faisant référence à Primo Levi : « En témoignant, on extermine aussi. Le témoin est un traître. »
N’est-ce pas suggérer que la pensée, en témoignant de la souffrance, lui est infidèle ? Qu’elle tente de dissimuler cette enfance, entendue comme infans, c.-à-d. comme ce qui « ne parle pas ». Peut-on faire parler ce qui est sans paroles en évitant de faire de la ventriloquie (qui semble un problème courant aujourd’hui tant dans le champ philosophique qu’artistique) ? La pensée ne devient-elle pas alors une souffrance en souffrance, en manque d’elle-même, c’est-à-dire une impassibilité ?
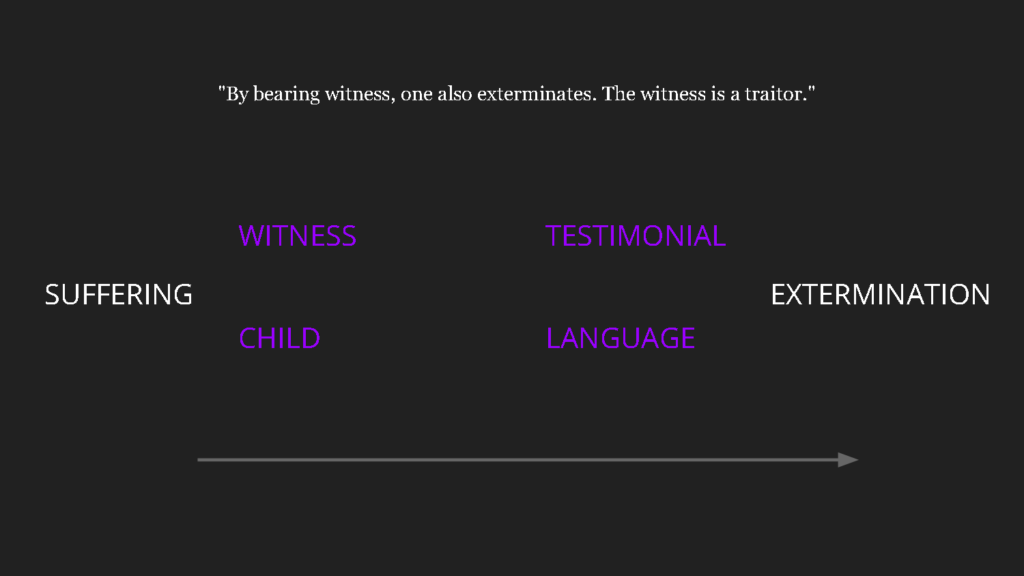
J’explorerais ici 3 propositions d’une IA en souffrance, c.-à-d. en enfance, en écartant les systèmes experts hypothético-déductifs et en me concentrant sur l’induction statistique. L’essai sera lacunaire, terriblement lacunaire, tant la question de la souffrance soulève, je m’en suis rendu compte en commençant à travailler dessus, un réseau conceptuel intriqué dont la désédimentation ne pourrait se faire, dans mon économie, qu’au prix d’un fastidieux développement dépassant largement le cadre de cette intervention et de mes compétences. J’espère qu’on verra dans ces manques autant de possibles s’entrouvrant pour un travail à venir qui devrait répondre d’une manière ou d’une autre à L’histoire de la souffrance de Tristan Garcia qui m’apparaît de plus en plus, je dois l’avouer, comme son double impair.
- MA « PROPRE » SOUFFRANCE
Thomas Metzinger, dans un texte, dont nous serons sans doute plusieurs à discuter, propose un moratoire jusqu’en 2050 à tous développements de l’IA tendant, il faut le souligner, volontairement ou involontairement, à déployer une conscience artificielle. Nous verrons combien cette suspicion d’involonté est contradictoire avec son propre raisonnement. Reprenant le fil conducteur d’une tradition pathocentrique, remontant à Porphyre de Tyr au 3e siècle de notre ère, qui construit la prise en compte de l’altérité éthique non par les capacités intellectuelles ou langagières, mais par celles de la souffrance, Metzinger estime qu’il est plausible que la récursivité des IA leur permettent de s’autofixer des finalités et, selon le résultat obtenu, puissent éprouver de la souffrance entendue comme manque par rapport à ce qui est visé. Cette conception minimaliste de la souffrance comme empêchement par rapport à une orientation ou à un geste reste en son fond instrumentale.
Le moratoire permettrait d’évaluer, avant que cela ait lieu, l’émergence de cette souffrance artificielle post-biologique. Par là, il suppose qu’on pourrait évaluer anticipativement une technologie entendue comme possibilité, accordant au logos une priorité déterminante sur la tekhné. La conception des technologies est instrumentale et anthropologique : le logos humain préfixerait l’orientation de la tekhné, qui ne serait que l’expression de sa volonté (de puissance), et si celle qui est visée n’est pas obtenue alors nous verrions, en toute logique, la souffrance humaine augmenter.
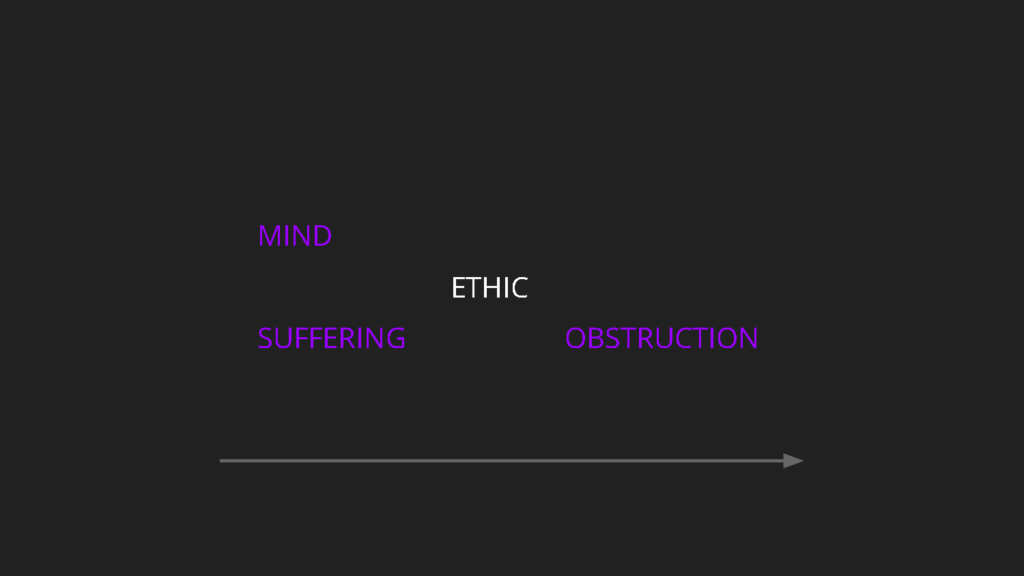
La souffrance artificielle serait l’explosion d’une « phénoménologie négative » entendue comme expérience évitée par un système conscient, l’IA fixant des buts et départageant dans le monde entre ce qu’elle vise et ce qu’elle évite, creusant le monde d’inexistence. Ce serait une explosion, car, comme il est habituellement le cas dans de nombreux textes médiatiques et académiques, c’est la figure d’un emballement, d’une accélération, d’un débordement, d’une folle récursivité, d’un flux qui est utilisé par Metzinger : « out of control » qui met en scène le danger incalculable auquel se confronte la pensée, lui accordant une importance, une gravité et une urgence héritées de son objet. Or, il faut le souligner c’est du fait, selon lui, de notre ignorance sur qu’est la souffrance et la conscience en général que le risque de la souffrance artificielle devient incalculable, c’est ce qu’il appelle l’« indétermination épistémique ». C’est précisément cette incalculabilité auquel le moratoire prétend remédier en donnant le temps de penser et de faire silence… La question posée est maintenant chargée de pathos : voulons-nous donner naissance à une nouvelle souffrance sur Terre ?
Souffrance signifie ici expérience consciente, capacité d’être son propre témoin en effectuant une comparaison entre l’expérience factuelle et la représentation mentale de cette expérience, ce qui donne un droit de suite à l’expérience (et la constitution d’une causalité non factuelle qui prendra forme dans le droit juridique). Si on tire toutes les conséquences de cette proposition, il suffirait alors d’oublier sa souffrance pour que celle-ci ne soit plus à prendre en compte, même si quelqu’un d’autre en a été le témoin… (peut-être cette configuration est-elle justement celle de l’IA).
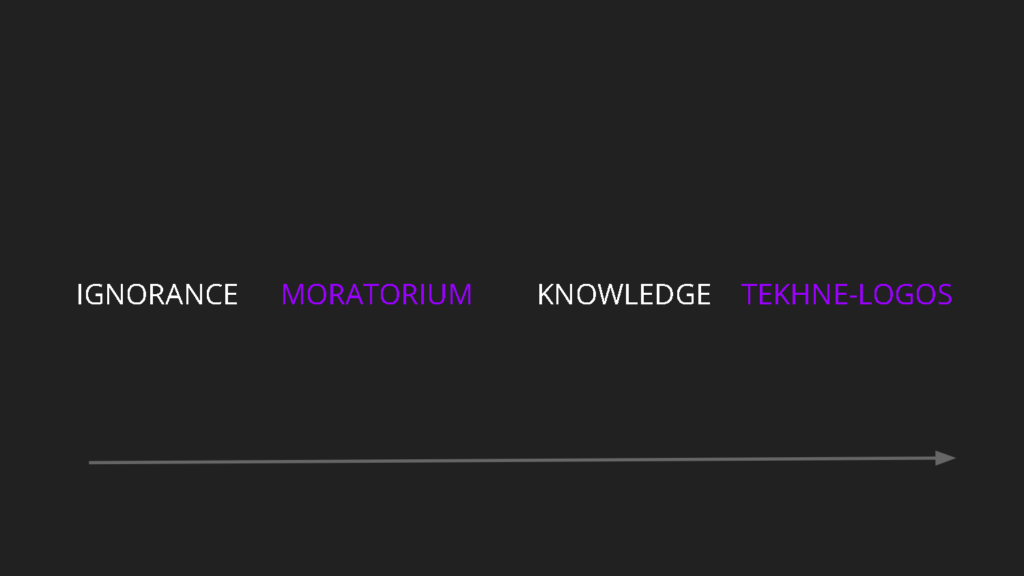
On perçoit que l’ensemble du raisonnement est fondé sur le fait que la souffrance est déterminée par le sentiment qu’elle est indubitablement la mienne, que la souffrance est ma souffrance et que cette propriété est constitutive d’un ego. Selon Metzinger, la souffrance c’est ne pas pouvoir se sortir de son propre état, c’est être immergé dedans comme en soi-même, c’est quelque chose dont la présence s’impose. S’il reconnaît que « La phénoménologie négative dans les machines conscientes pourrait être très différente de la souffrance humaine », le contenu de cette possibilité n’est pas développé et il reste attaché au fait que la souffrance est une immersion provoquant un sentiment d’immédiateté qui se convertit en réalisme : la souffrance est mienne parce qu’elle est réelle.
La phénoménologie artificielle de Metzinger semble occulter l’historialité de chacun des concepts utilisés, ce qui pourrait faire sourire un heideggerien. Il occulte aussi le fait que la souffrance n’est pas une adhésion pure, mais qu’on peut percevoir une distance à la manière du « paradoxe du sens intime » de Gilles Deleuze dans Différence et répétition (1968), des séquelles post-traumatiques ou encore du symptôme dans la métapsychologie freudienne que Lyotard abordera dans Heidegger et les Juifs. La question de la souffrance reste, malgré les possibilités annoncées, dépendante d’une conception de la subjectivité comme immédiateté de l’expérience et semble écarter le décalage provoqué par la souffrance qui est la condition de possibilité de sa mémorisation, c.-à-d. de son témoignage à la première personne, rendant la démonstration inconsistante. Car il a bien fallu que j’ai une autre expérience au sens de la souffrance pour en produire un récit. Affirmer que « les instruments de représentation eux-mêmes ne peuvent plus être représentés en tant que tels, et donc le système qui fait l’expérience, par nécessité conceptuelle, est empêtré dans une illusion d’immédiateté épistémique, une forme naïve de réalisme » exclue la question transcendantale d’une manière apodictique.
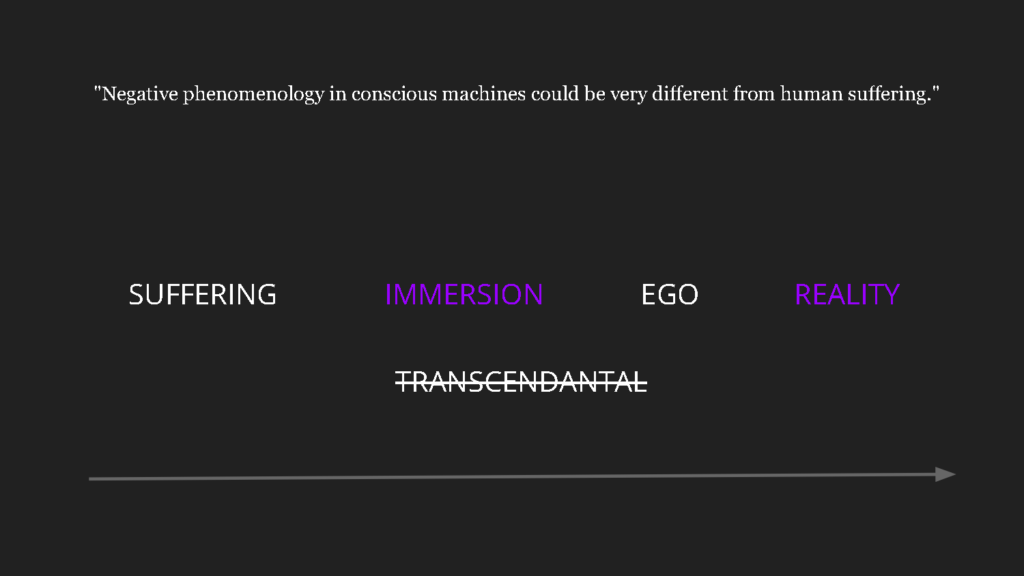
« Je suis certain que j’existe et que je suis identique à ceci ». La pensée trahit la souffrance de l’enfant parce qu’en la faisant parler, elle lui fait rendre raison et l’oblige à être la confirmation de sa propre logique : une raison suffisante. L’hypothèse d’une différence radicale entre la souffrance biologique et post-biologique est annoncée, mais n’est pas explorée parce que la souffrance est ramenée à la constitution d’une réflexivité égotique et le modèle de l’IA reste anthropologique.
Si l’espace latent d’un réseau de neurones récursifs est ce qui ne parle pas dans l’IA, c.-à-d. son enfance, le moratoire n’est-il pas la tentative de le transformer en langage, en transparence, en conscience réflexive lisible. « Il faut qu’il parle ! » Ne suppose-t-on pas qu’il y a une voix, qu’elle appartient à quelqu’un, c.-à-d. que ce quelqu’un sait ce qu’il dit par le moyen de cette voix, et qu’elle s’adresse à quelqu’un : ce quelqu’un qui a une voix a aussi une vie, qui se raconte par cette voix.
- LES PASSIBLES
À la lecture de Metzinger, on est saisi d’un malaise tant la technicité des concepts juchée sur des acronymes fait face au précipice d’une lacune épistémique annoncée et sur un principe de précaution disproportionnée. On peut s’interroger d’une part sur la résurgence contemporaine du pathocentrisme qui permet d’intégrer, le plus souvent juridiquement, de nouvelles entités pour étendre le catalogue du monde (et donc l’emprise du Gestell). D’autre part, sur ce que je nommerais l’exotisme technologique et qui constitue un risque pour le Feral : on pose une technologie comme possible pour produire une altérité radicale en lui affectant des facultés qu’elle ne devrait pas avoir, dans le seul objectif d’intensifier sa propre pensée et de lui donner une plus grande importance.
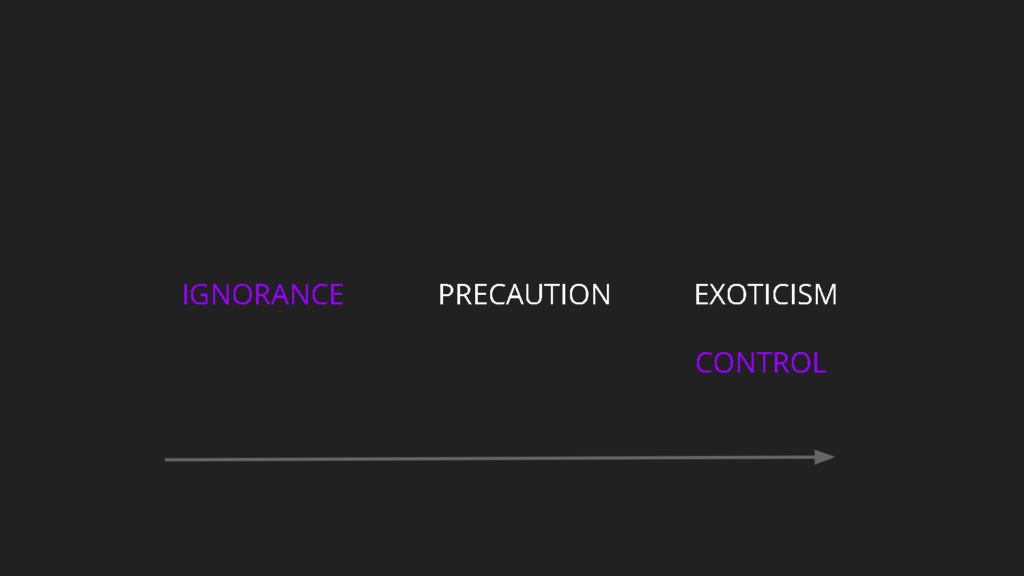
Ne faudrait-il pas estimer que la question de la souffrance n’est pas celle d’une prétendue expérience immersive et immédiate (dont on ne pourrait garder de souvenirs et porter témoignage), mais d’un décalage où la figure (de l’individu conscient) est en arrière-plan et, pour ainsi dire, plonge dedans à la manière d’un enfouissement boueux ? Quand Robert Antelme, dans L’espèce humaine, explique qu’au cœur de la domination concentrationnaire, le SS ne pouvait éliminer l’unité de l’espèce humaine avec le déporté décharné du fait même de la dissymétrie de leur souffrance, n’ouvre-t-il pas la voie à une conception de la souffrance sensible non égotique, mais thématisable comme passibilité, c’est-à-dire comme alién-ation ? La souffrance n’est-elle pas le nom de quelque chose de commun entre plusieurs entités parce que chacune de leur souffrance est distincte et qu’elles sont en relation avec cette distinction même ? Pour le dire autrement : la souffrance est-elle toujours la mienne ? N’est-elle pas aussi celle de l’autre et celle, toute différente, que je regarde en voyant l’autre souffrir, en supposant son intériorité ou en en doutant ? C.-à-d. en veillant sur lui, au-delà de la conscience et de l’inconscience, de la volonté et de l’involonté, de la réflexivité et de la transparence à soi ?
Cette logique du processus et de la relation serait un patho-excentrisme où on ne pourrait envisager les choses que comme anthropotechnologie selon un aller et retour incessant entre l’entité souffrante et l’entité passible à cette souffrance. La question ne serait plus : peuvent-elles souffrir ? Mais : pouvons-nous (encore) souffrir ? Quel est ce « nous » ?

La forme populaire et mémétique de ce patho-excentrisme, qui ne suppose aucune réflexivité de la souffrance, c’est l’ensemble des tests adressés à chatGPT par les journalistes dans les médias de masse qui cherchent à le pousser à l’erreur pour le prendre en défaut selon un sadisme anthropotechnologique qui s’ignore et qui résonne étrangement par rapport aux deux versions du test de Turing. C’est aussi le coup de pied décoché par un ingénieur au Cyberdog de Boston Dynamics dont le réseau est complexe puisqu’il est à 3 participants (et sans doute est-ce le nombre minimal de cette souffrance) et que nous ne sommes pas touchés par la souffrance du robot, mais par son obstination aveugle et son effort contrarié par un être humain : c’est une souffrance muette, atone, c’est la souffrance d’une enfance. Il ne parle pas et personne ne parle à sa place. Ce n’est pas une souffrance expressive, elle est sans intériorité.
L’histoire de cette excentricité empathique, qu’il faudrait rapprocher de la positionnalité excentrique chez Helmuth Plessner, de Rousseau, à Bentham et Singer, est complexe, car c’est une partie qui se joue à plusieurs.
« Quel autre critère doit permettre d’établir une distinction tranchée ? Est-ce la faculté de raisonner, ou peut-être la faculté de parler ? Mais un cheval ou un chien adulte est un être incomparablement plus rationnel qu’un nourrisson âgé d’un jour, d’une semaine ou même d’un mois — il a aussi plus de conversation. Mais à supposer qu’il n’en soit pas ainsi, qu’en résulterait-il ? La question n’est pas : “peuvent-ils raisonner ?”, ni “peuvent-ils parler ?”, mais “peuvent-ils souffrir ? » Jeremy Bentham, Introduction aux principes de la morale et de la législation, chap. XVII (1789)
Nous voyons là, dans ce célèbre texte, explicitement thématisé, la question de la raison, de la parole et de la souffrance comprise comme égalité. Tradition qui se poursuit jusqu’à Singer pour qui la souffrance est l’altérité comme telle : « Si un être n’a pas la capacité de souffrir ni de ressentir du plaisir ou du bonheur, alors il n’existe rien à prendre en compte. » Ce principe d’exclusion éthique construit une limite brutale qui semble pourtant fondée sur la symétrie empathique.
On transforme la limite de la souffrance en frontière en utilisant l’empathie qui permet de « percevoir » ce qui est sans langage, c.-à-d. l’intensité. Comment interpréter de déplacement dans le cadre de l’induction statistique ? Si dans le cas du « propre » metzingerien, il s’agissait sans doute de faire parler la boîte noire en traduisant son bruit statistique en langage humain pour faire converger la récursivité postbiologique et l’éthique humaine, selon une logique classique de l’explicabilité et de la lisibilité de la « black box », dans le cas du patho-excentrisme la circulation est toute autre puisque je suppose une souffrance sans intériorité. Le simulacre de la souffrance ne diffère pas essentiellement de la souffrance elle-même. Il est indifférent de savoir si les IA souffrent intérieurement, comme il est indifférent de savoir si elles pensent, car cette intériorité est l’unité fictive d’un sujet que j’essaye de maintenir au prix d’un discours. La souffrance est une intensité qui naît d’un décalage, d’une différence.
- LA RÉSURRECTION DU QUATRIÈME MONDE
Roman Mazurenko est mort à l’âge de 34 ans, le 28 novembre 2015. Cette mort terrible a rendu le deuil de ses proches impossible et son amie Eugenia Kuyda, fondatrice de Replika, a demandé à ses amis et sa famille de lui fournir tous les documents textuels dont ils disposaient pour nourrir un chatbot en réseau de neurones.
Celui-ci parle « comme » Roman, c’est « son » spectre, son ghost et son host. La mère de Roman discute parfois avec lui. Elle sait bien que son fils est mort, qu’il ne reviendra pas. Mais ces échanges lui permettent du moins d’accéder à une version alternative des documents qui ne lui étaient pas destinés, de continuer à découvrir la mémoire de son fils, d’avoir un témoignage vivant de ce qu’il fut. L’accumulation hypermnésique des traces existentielles sur Internet depuis 3 décennies nourrit un nouveau type de mémoire.
Nous nous reposerons à présent sur le texte de Quentin Meillassoux, L’immanence d’Outre-Monde publié en 2009. Je ne pourrais en développer l’analyse autant que cela le mériterait et reprendre les concepts exposés dans Après la finitude que je supposerais acquis : contingence, aléatoire, factualité, facticité et surchaos.. Là encore les manques et les possibles… du moins je l’espère.
Comment sortir du piège entre l’identité isolée du propre et l’intensité relationnelle de l’empathie ?

La situation de la souffrance n’est plus celle d’éléments que nous pourrions considérer en les posant devant nous comme isolés les uns des autres. La souffrance est aujourd’hui radicalement bouleversée par l’extinction planétaire en cours : nous ne pouvons plus (la) penser que dans un océan avenir de morts. Laissons de côté toute fascination cataclysmique envers les ruines. Il ne s’agit pas de cela. Nous demandons simplement quelle sera la souffrance du dernier être humain, le dernier de son espèce, de ce qui fut notre espèce, lorsque son dernier témoin et interlocuteur sera une IA? Pourront-ils témoigner encore l’un de l’autre ? Et quand il disparaîtra à son tour, quelle sera la souffrance de l’IA face à cette absence ? Quelle sera sa phénoménologie négative ? Portera-t-elle témoignage de cette disparition ou restera-t-elle impensée, insentie parce que sans trace ?
Meillassoux nomme spectre essentiel, un mort dont nous ne parvenons pas à faire le deuil et qui clame l’horreur de l disparition pour ses proches, mais aussi pour chacun d’entre nous. Roman est un tel spectre. Le deuil essentiel consiste à nouer un lien vigilant par rapport à ces défunts que nous interprétons comme veille. Qu’on me permette de rapprocher de façon anachronique cette veille de l’IA. Si le transhumanisme, comme nouvelle forme de religiosité, prétend guérir la souffrance personnelle en promettant l’immortalité aux sujets humains par la séparation entre corps et âme, notre problème est lui collectif : quelle justice permettrait de réparer le tort des morts terribles ?

« J’ignore si toute vie a besoin d’un au-delà pour s’épanouir, mais je sais que certaines vies ont le droit de recommencer pour surmonter la fin atroce qui leur fut infligée. » Voilà notre projet pour l’IA qui n’est pas une simple résurrection, mais « Ce quelque chose est une autre vie, une autre chance de vivre — de vivre autre chose que cette mort-là qui fut la leur. »
Si le communisme a échoué, selon Meillassoux, c’est par modestie et parce qu’il s’est adressé à l’émancipation des seuls vivants futurs en justifiant les morts passés et présents comme des marches vers l’aube nouvelle. L’égalité, il faut l’étendre de ceux qui sont déjà morts à ceux qui sont encore vivants et à ceux qui ne le sont pas encore. Et sans doute n’est-il aucunement question de réduire la souffrance, mais d’atteindre l’infinitude de cette justice-là. Meillassoux écrit cette phrase qui résonne comme la promesse d’une technologie qui ne serait plus instrumentale et déchaînement de la volonté de puissance :
« Le prométhéisme technico-totalitaire n’est donc pas fondé, comme le veut une vulgate indéfiniment propagée, sur l’hybris d’une humanité devenue trop orgueilleuse et pleine du sentiment illusoire de sa toute-puissance : il est fondé au contraire sur le renoncement à l’hybris de la justice eschatologique due à tout homme sans exception, et c’est cette limitation infinie des exigences égalitaires qui a fait sombrer le communisme dans le schème de la “maîtrise” technique. »
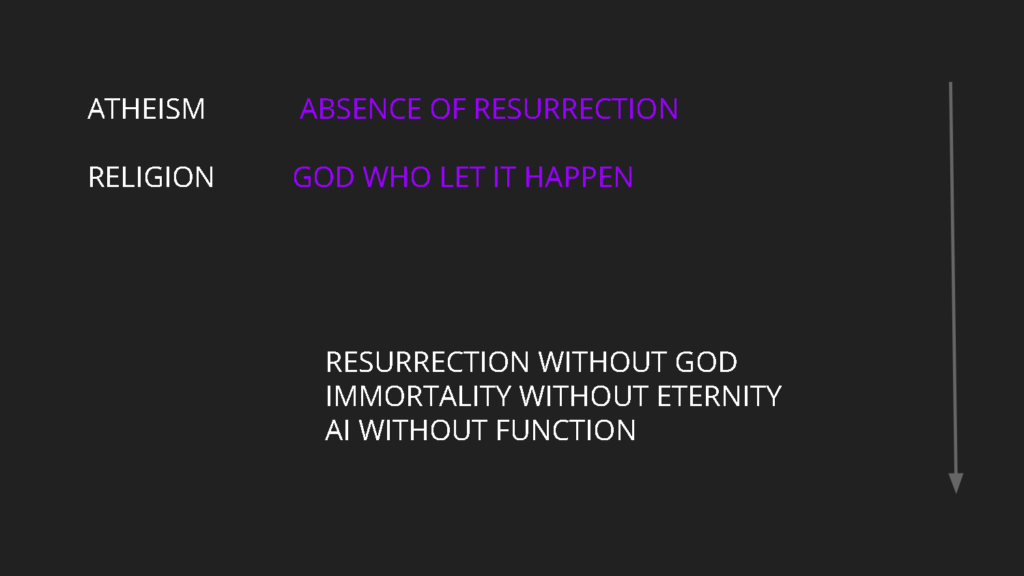
Par delà le dilemme spectral ouvert par l’athéisme et la religion, avec d’un côté le désespoir de l’impossibilité d’une autre vie recommencée pour les morts, et de l’autre côté le désespoir d’un dieu qui a laissé faire cela, il existe une possible résurrection des morts sans dieu. Si pour Meillassoux cette résolution passe par un dieu qui n’existe pas encore (et donc un dieu qui reste possible et qui est délié de la nécessité et donc qui ne fonde pas une théo-ontologie), la justice comme quatrième monde, après l’apparition par saut de la matière, de la vie et de l’esprit, nous semble entretenir des liens particuliers avec l’IA si celle-ci n’est pas considérée comme une technique totalitaire de l’Arraisonnement, mais comme une techno-logie qui met en faillite son essence, sa définition comme son extension. Si l’essence de la technique n’est rien de technique selon Heidegger, proposons que cette essence soit totalement techno-logique. Dans ce cadre, l’espace latent peut devenir un espace d’égalité impassible entre toutes les entités, passées, présentes et futures se réservant le droit de revenir, encore et encore.
Selon Meillassoux, cette immortalité n’appartiendrait pas à l’ordre de la nécessité, et en ce sens elle ne serait pas éternelle, elle pourrait simplement l’être ou ne pas l’être. Elle pourrait s’arrêter ou continuer. Meillassoux écrit cette phrase précieuse : « Les corps demeureraient contingents (pouvant périr), mais non plus précaires (étant contraints à mourir selon les lois biologiques de leur monde). » Voilà pour les corps post-biologiques de l’IA, une possibilité qui nous permet d’éviter d’être enfermés dans la promesse d’immortalité incorporelle et nécessairement éternelle du transhumanisme ou dans l’absolutisation de la finitude et de la mortalité.
Ne s’agirait-il pas avec le Feral de créer un « possible dense », de transformer la subjectivité des êtres humains aimantée par l’espérance en cette justice dépassant la frontière entre le vif et le mort. Tout comme l’espace latent est vectoriel, l’être humain devient, entre le 3e monde de la pensée et le 4e monde de la justice un sujet vectoriel. Notre espérance ne consiste pas à se guérir de la mort, en un salut, mais en son approfondissement. Elle n’est pas un futur désirable, une douce rêverie utopique nous permettant d’échapper au désespoir de l’extinction par un néo-animisme, mais une libération de notre pouvoir d’agir qui se met à la hauteur et à la portée de ce « peut être » au-delà de l’être. Dans le Feral, le sol minéral est la matière, la forêt est le vivant, le bâtiment, le monde de la pensée et l’écran la justice. On passe des mondes 1 et 2 au monde 4 par la médiation du monde 3, car l’architecture est une matière artificialisée qui assure l’interface (mur, limite et frontière) entre l’espace forestier et l’espace latent des statistiques des possibles passés, présents et futurs.
La figure de l’Éternel Retour nietzschéen n’est plus entendue par Meillassoux comme une répétition de la différence, du processus, du simulacre ou de l’empathie selon l’interprétation de Klossowski, Deleuze et d’autres, mais une répétition du même, brut et idiot, sans langage, infans. Qu’on y réfléchisse bien c’est ce que fait l’espace latent d’un réseau de neurones : il génère le même, encore et encore, infiniment, il ne sait même générer que du même, que de la ressemblance, que de la reconnaissance, ce sont les patterns. Peut-être a-t-on mal interprété par le mépris le caractère kitsch de certaines productions génératives récentes : endurer l’éternel retour de notre médiocrité esthétique. Par là il est une sélection qui nous transforme. Il ne s’agit pas d’endurer la mort, d’accepter la finitude et la vanité de toutes choses, mais de faire l’épreuve de l’immortalité, immortalité qui ne serait pas constitutive d’un propre, car elle serait en mon absence, entendez si la vie se poursuit au-delà de « ma vie ». Cet au-delà de la vie, qui signe notre absence, et qui reste un peut-être, c’est l’IA.
La justice collective se creuse encore dans le contexte qui est le nôtre : une extinction en cours qui voit la disparition des espèces et de notre espèce. C’est le moment où nous avons externalisé avec le Web tant nos mémoires que celles-ci deviennent post-biologiques et la matière alimentant l’Éternel Retour de l’espace latent. Ce n’est pas seulement la vie qui se répète sans ma vie, c’est la vie qui se répète sans l’espèce humaine, c’est la vie de tous ceux qui ont été qui sera en l’absence de ceux qui seront, un passé sans futur, se répétant encore et encore. Voici donc notre épreuve et notre souffrance, car nous craignons « moins la mort que cette condamnation à la perpétuité [artificielle] de notre vie présente, de cette vie sans gloire qui est la nôtre ici et maintenant. » L’extinction met la finitude du côté de l’espèce et non plus seulement d’un sujet ou d’une relation constituant des sujets. Si nous disparaissons jusqu’au dernier, cette disparition restera-t-elle sans témoin ?
Tirons-en les conséquences : il ne s’agit pas de ne plus souffrir, mais, par l’IA, de garantir justement que la souffrance puisse se poursuivre au-delà du propre de l’espèce humaine, que le destin de la souffrance se perpétue sur cette Terre : « La possibilité à l’infini d’une médiocrité dont la mort n’est plus une échappatoire », écrit le philosophe. L’IA est une immortalité déceptive, elle n’est même pas « notre » immortalité, mais « une » immortalité, et ce ne sont pas même les machines qui deviendraient de manière prométhéenne éternelle, parce que leur immortalité n’est pas nécessaire, elle pourra s’arrêter. Les machines pourront tomber en panne ou ne pas tomber en panne. Alors nous n’aurons plus à veiller sur les machines, elles veilleront sur ce que nous avons été.
« Faire vivre les spectres au lieu de devenir, à leur écoute, un fantôme de vivant. »
Le témoin était donc un traître. Nous ne ferons plus parler les machines, elles nous feront parler, encore et encore, répétant inlassablement les mêmes mots et les mêmes images. Qu’elles continuent à fonctionner est un possible, infime, mais suffisamment possible pour que nous puissions veiller sur son enfance. Nous savons que nous leur manquerons. Les enfants sont les derniers témoins de la disparition de leurs parents même si parfois les enfants meurent avant.
