La ville qui n’existait pas 1 : catalogue
Pour la première année de La ville qui n’existait pas, un catalogue produit avec le soutien du groupe Partouche.
La couverture de chaque ouvrage est unique avec une image générée. Le livre présente, en quatre parties, le projet de cette année autour d’une fiction littéraire du Havre allant de 1895 à 1971 et comporte deux entretiens, l’un avec Jean-Marc Thévenet et l’autre avec le commissaire d’un Ete au Havre, Gael Charbeau.
350 exemplaires numérotés et hors commerce
–
For the first year of La ville qui n’existait pas, a catalog produced with the suppoort of the Partouche group.
The cover of each book is unique, with a generated image. In four parts, the book presents this year’s project based on literary fiction of Le Havre from 1895 to 1971, and includes two interviews, one with Jean-Marc Thévenet and the other with the curator of Un Ete au Havre, Gael Charbeau.
350 numbered copies, not for sale
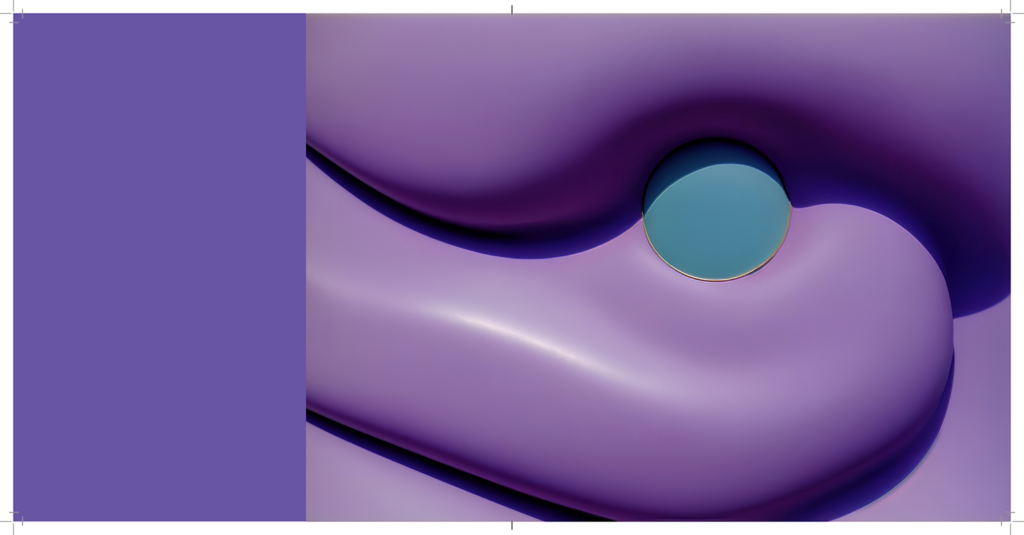




Gaël Charbau : “La ville qui n’existait pas” est une proposition que tu as imaginée en réponse à ma proposition d’investir toute la ville du Havre, en particulier les quartiers éloignés du centre historique (dit “centre Perret”). En partenariat avec le bailleur social Alcéane, ce sont vingt-cinq pignons d’immeuble, du quartier de Bléville à celui des Neiges en passant par Caucriauville, qui accueillent ton projet pour le moins singulier. Sur ces grandes façades, les habitants vont en effet découvrir d’étranges versions et visions de leur réalité quotidienne, où la ville semble se réécrire sur elle-même. En 2022, tu as d’abord nourri une intelligence artificielle avec des photographies issues des archives du Havre1. Tu as ensuite introduit dans le procédé tes propres photos de l’environnement immédiat des immeubles, pour finalement générer des grandes fresques insolites qui mêlent des architectures, des corps, des paysages et des formes issues d’une mystérieuse industrie… Ce que montrent ces images n’existe pas, elles ne sont pas “vraies”, mais elles produisent un grand sentiment de véracité. Elles fourmillent de détails qu’on suppose issus de notre présent, elles semblent nous raconter quelque chose, mais comme dans un rêve difficile à reconstruire, elles échappent à toute narration logique… Elles sont pourtant formidablement expressives! Pourquoi as-tu choisi de faire ainsi disjoncter, dans l’espace public, les circuits du monde réel ?
Grégory Chatonsky : Quand on investit l’espace public, on craint le rond-point : un objet est posé là, hors situation ou littéralement socio-documentaire. Une fois le travail réalisé, et le vernissage passé, l’artiste repart satisfait tandis que les habitants subissent cette présence pendant des années. Et puis, il y a la question du financement qui participe du même soupçon, car c’est le labeur des citoyens qui permet de rémunérer les artistes et d’assurer leur liberté de travail. C’est une responsabilité à laquelle j’ai pensé en explorant les différents endroits qu’on m’a proposé. Je n’ai pas résolu ce doute qui est encore accentué par la dégradation des conditions de vie des plus précaires.
Ayant passé mon enfance et une partie de mon adolescence dans un ensemble à vocation sociale, je sais qu’une œuvre peut bouleverser une vie et introduire du possible là où les déterminations semblaient devoir prendre le dessus et combien cet espace incertain peut devenir la seule certitude dans la désorientation du monde.
J’ai réalisé une série qui est disséminée dans la ville et qui raconte en une vingtaine de tableaux un monde qui n’existe pas, mais qui est proche du nôtre. Tout se passe comme si un autre univers entrait progressivement dans la réalité du fait de sa ressemblance ambiguë : une réalité commune et inextricablement distincte.
On y reconnaîtra des documents d’archives de la première moitié du XXe siècle, avant la catastrophe qu’a vécue la ville pendant la Seconde Guerre mondiale, des documents étendus et modifiés, réparés et hallucinés par un IA générative. Ils se télescopent avec le présent, des fragments que j’ai pu photographier lors de mes visites. C’est le pan de mur d’une école primaire, un arbre en bas, une simple fenêtre, un linge étendu. Ce sont des signes envoyés aux habitants, car ils seront les seuls à pouvoir reconnaître ces furtives présences. Je ne souhaitais pas les renvoyer à leurs propres existences et identités, mais rendre sensible la relation entre la réalité et la fiction, entre le passé historique et l’incertitude du présent. Qu’avons-nous encore de commun ? Qu’est-ce qui nous distingue les uns des autres ?
Il y a dans ces images une richesse baroque de détails, qui les inscrit dans la longue tradition de la fresque : comment se perdre dans une image à une époque où nous en sommes saturés ? Comment passer d’une vision d’ensemble à une vision rapprochée ?
D’une image à l’autre, en parcourant la ville, on découvrira une fiction incertaine comme un rêve psychédélique qui se matérialisera au fil des deux prochaines années à la manière d’une série télévisée. Quelque chose est raconté, mais nous en cherchons encore le sens, et moi le premier. Comme si j’en étais moins l’auteur que le spectateur : un peuple est tourné vers l’océan et attend quelque chose. Certains lisent, d’autres font la sieste, la vacance. Le paysage est constitué de machines et de racines, de câbles et de déchets. La technique et la nature, aussi différentes soient-elles, semblent proliférer de concert dans l’immense machinerie que fut la révolution industrielle. Des formes abstraites violettes sont tirées hors de l’eau… Puisque ces images sont au passé, nous savons que cela n’a pas eu lieu, mais cela pourrait avoir lieu : au futur antérieur.
L’imagination, c’est-à-dire les images réalistes qui ne sont pas réelles, m’a toujours semblé le meilleur moyen pour nous renvoyer vers quelque chose de la réalité. Non pas le monde quotidien et comme atténué par l’habitude, mais une intensité qui nous blesse et nous rend sensibles à ce qui n’est pas et qui pourrait naître. C’est pourquoi ces images mêlent, grâce à l’IA, des éléments indiciels et d’autres fictifs. C’est un autre monde, mais imbriqué dans celui-ci et qui est tout aussi réel que lui. La ville est le corps sur lequel s’écrit ce possible conjugué à l’impossible, une fiction qui traverse les anonymes.
Lorsque les conditions sociopolitiques et climatiques constituent un rappel au caractère irréductible de la réalité, il peut sembler étrange de divaguer ainsi sur des réalités alternatives. N’est-ce pas une manière de nous échapper de l’impératif pratique ? N’est-ce pas une inutile décoration au moment où les luttes se multiplient ? J’aimerais croire que l’imagination, quand elle n’est pas une simple représentation mentale, mais quand elle est une aliénation désirée, participe, plus que tout autre réalisme à cette époque si particulière que nous sommes en train de vivre, et pourrait nous permettre de passer de la résistance à l’affirmation.
Gaël Charbau : Ce déploiement de fresques, sur la ville elle-même, s’accompagne d’une autre proposition tout aussi singulière: tout au long de la saison 2023 d’Un été au Havre, nous allons diffuser gratuitement auprès du public plus de vingt cinq mille cartes postales, toutes uniques et numérotées. Dans cette série, tu nous projettes à nouveau dans une ville qui “ressemble” au Havre, dans un passé qui pourrait se situer entre les années 1950 et 1970. On y voit des moments de la vie quotidienne où la ville et les habitants semblent cohabiter naturellement avec des formes violettes qui se sont développées dans tous les espaces, depuis la mer et la plage jusqu’aux immeubles et à toutes les échelles: elles apparaissent tout autant sur des vêtements, des chapeaux que sur des pelouses, dans les espaces intimes autour du corps humain et dans l’immensité de l’espace public ou maritime. Ces cartes postales documentent, avec une troublante véracité, un passé qui n’a jamais existé…
Grégory Chatonsky : La carte postale est un support humble qui semble appartenir à une époque révolue et dont l’existence se maintient au-delà de son utilité, à la manière d’une technique zombie. C’est une image impersonnelle qu’on envoie à un destinataire que l’on connaît personnellement, paradoxe qu’avait abordé Derrida dans son ouvrage éponyme. Recto une image pour tou.te.s, verso un texte pour un.e seul.e. Ce pourrait être une assez bonne définition de l’œuvre d’art.
Depuis une quinzaine d’années, j’explore l’hyperproduction, c’est-à-dire des séries potentiellement infinies constituées d’éléments uniques générés par des processus automatiques. Cette production permet de déconstruire la notion de valeur, par exemple dans le marché de l’art, et de déborder le consumérisme par l’accélération productiviste. Si chaque carte postale est unique, quelle en est la valeur ? Sachant qu’elle n’est pas seule à être seule (tout comme nous). Elle a quelque chose de commun et de distinct, de pauvre et d’opulent. Selon Platon dans Le Banquet, Éros naît de l’accouplement entre ces deux polarités.
Ces cartes sont le résultat d’une longue exploration de l’espace latent. On nourrit une IA de milliers d’images, elle calcule des statistiques qui lui permettent de générer un nombre infini de photographies ressemblantes, mais différentes. L’espace latent est purement statistique, il n’y a encore aucune image, seulement des points et des paramètres que l’on peut explorer grâce à des mots qui sont autant d’amorces de narration : à la manière d’un aveugle, les mots sont une canne qui nous permet de percevoir l’espace latent à distance, de nous munir d’un nouvel organe perceptif.
J’ai dérivé dans ces lieux numériques pendant des mois, me laissant guider, cherchant la désorientation. Progressivement une narration a émergé, à la lisière indiscernable entre les instructions que j’écrivais et les surprises que la machine me procurait : les habitants de cet autre Havre attendent sur les rivages des formes abstraites que d’intrépides adolescents ramènent. Elles deviennent alors le centre de l’attention et toute la vie sociale semble s’articuler autour d’elles selon de mystérieux rituels. Leur empire s’agrandit chaque jour, s’insinuant dans les vêtements, devenant un organe de chaque corps.
Le violet est apparu dans une de ces images et j’ai tiré ce fil, je l’ai accentué, j’y suis revenu sans cesse comme une obsession formelle, car c’est une couleur informatique. Esthétiquement, elle est associée aux ordinateurs de mon enfance, puis à ce qui s’est nommé, il y a une quinzaine d’années, le postdigital. Elle est devenue, à mes yeux, la couleur de la matérialisation du numérique, sa sortie dans l’impureté du monde.
Cette seconde période du Havre est une utopie, au sens politique. Elle présente une société fondée sur la sieste, la danse, la lecture et le rituel. C’est ce qui s’était tenté dans les années 60 et 70 aux USA entre les ouvriers et les étudiants. Cette apparente paresse ne consiste pas à ne rien faire, la ville fourmille au contraire d’activités, mais à pouvoir s’arrêter quand on le souhaite, afin de rompre avec la domination dont le moyen et la fin est de nous priver du temps, c’est-à-dire du sentiment d’exister.
Ce que Mark Fisher a nommé le réalisme capitaliste nous prive même de l’avenir, du temps inanticipable et incalculable. Quand Thatcher dit « Il n’y a pas d’alternative », elle naturalise et essentialise des choix politiques qu’elle présente comme la fin de l’histoire. Il n’y aurait pas de choix, nous devrions faire avec : fin du possible et commencement de l’impossible, c’est-à-dire aujourd’hui de l’invivable et de l’inhabitable au nom du réalisme. Pour produire une perspective du possible, il faut déconstruire le passé, le réparer, le compléter, y revenir sans cesse avec autant de variations qu’il y a d’êtres distincts. Montrer que même ce qui est passé ne passe pas, mais revient nous hanter, car chaque époque interprète différemment ce qui a eu lieu. Il n’y a pas d’origine ni de propre. Le futur est là aussi antérieur.
Esquisser une autre société dont le Havre aurait été le chantier, après la reconstruction des années 50, c’est précisément réouvrir le possible, car celui-ci ne concerne pas seulement le futur, mais tout bien aussi le passé, mais un passé postérieur, après-coup : le soir venu, chacun je crois revisite les événements de la journée. On imagine d’autres embranchements. Et si les choses s’étaient déroulées autrement ? Si j’étais resté proche de cette personne aimée ? Si je lui avais dit véritablement au revoir ? La série des « Et si » est infinie et chacun des possibles qu’elle fantasme est unique, jusqu’à ce que dans l’obscurité, on se mette à rêver d’être un.e autre. Nous nous endormons réconfortés par cette aliénation enfin désirée.
Gaël Charbau : Dans “New york Délire”, publié en 1978, Rem Koolhaas compare le développement de New York à une machine délirante où la distinction entre le naturel et l’artificiel aurait cessé d’exister, où la frontière physique et psychologique entre le factice et le “vrai” se serait vaporisée. L’explosion de la population, de l’information et des machines a contribué selon lui à créer une ville anarchique, dont Manhattan fût le laboratoire, “le produit d’une théorie informulée, le manhattanisme(…) [qui propose d’] “exister dans un monde totalement fabriqué par l’homme, c’est-à-dire vivre à l’intérieur du fantasme(…)”. Il formule dans cet ouvrage une équation qui m’a beaucoup marquée : “Technologie + carton-pâte (ou tout autre matériau inconsistant) = réalité.” Pourrait-on aller encore aller plus loin que Koolhaas et considérer que la technologie elle-même est un “carton pâte”.
Grégory Chatonsky : Si l’immersion dans le monde, en tant que simulacre humain, peut effectivement produire une jouissance de l’abîme, nous savons qu’elle a des limites et que nos fantasmes consument littéralement la planète, que la circulation de nos images sur le réseau n’est pas dans le ciel abstrait des nuages, mais exploite des ressources matérielles et humaines. La volonté de puissance, qui est à l’œuvre dans l’urbanisation, est mortifère parce qu’elle considère la Terre comme un matériau disponible, une ressource à extraire, à transformer et utiliser. Comment sortir de ce cercle de l’usage, sachant que nous ne pouvons pas simplement suspendre la technique, que notre humanisation est aussi une technicisation ?
C’est là que l’ontologie du carton-pâte technologique proposée par Rem Koolhaas est efficace : la jouissance du simulacre n’est pas la surpuissance du transhumanisme, le dépassement et l’effacement de nos limites physiques, de la mortalité et de l’idiotie, mais l’affirmation d’une hyperfinitude. Si on envisage l’IA comme une augmentation de la pensée humaine, on sera déçu, car ses résultats sont souvent de « carton-pâte » : cela sonne faux, il y a des erreurs, des incohérences et cela se voit ! D’ailleurs quand on « parle » avec chatGPT, on a le sentiment qu’il est pris dans une boucle comme une personne âgée dont la vie s’éloigne dans les vapeurs de sa mémoire. Quelque chose n’est pas aligné avec les technologies, et ne peut pas l’être, car le simulacre doit s’affirmer dans la puissance du faux, du semblant et de l’art. Le simulacre c’est l’inconsistance conquise : nous savons que tout cela est faux, mais à un endroit où le faux nous ressemble de plus en plus.
C’est sans doute la raison pour laquelle je me suis tenu à distance de l’art numérique qui utilise les technologies comme de nouveaux moyens d’expression ou pour les dénoncer de façon critique. Il y a là une foi moderniste en un art total, un art immersif ou un art pastoral. J’ai souvent réalisé des dispositifs se montrant dans leur fragilité, avec les limites de mes compétences, fonctionnant peu ou mal. Je ne voulais pas qu’on y croit ou qu’on soit impressionné par le résultat, je voulais qu’on voit le carton-pâte et qu’on soit ému par la finitude technologique si proche et distincte de la nôtre.
Ceci accorde une importance stratégique à l’art dans l’époque actuelle : dans un monde tissé de simulacres techniques, nous les envisageons de façon instrumentale comme le moyen de certaines fins fixées par notre volonté. L’objectif est finalement de nous guérir, de nous soigner de notre bêtise, de la mort, de la séparation, etc. L’art, tel que je l’entends, ne soumet pas une technique à sa volonté, elle n’est pas le moyen d’un projet. Il permet de l’expérimenter, c’est-à-dire associer l’action et l’expérience, en suspendant la volonté, en essayant, en ratant, en ratant encore et mieux. Par là même l’œuvre d’art révèle l’essence véritable de la technique, mais aussi de notre ontologie carton-pâte. Comme l’estimait Klossowski dans la Monnaie vivante, l’utilité d’un objet technique n’est gagnée que parce qu’il est un simulacre. J’aimerais que le Havre redevienne le simulacre qu’il n’a jamais cessé d’être, que la liberté se gagne par les possibles, qui comportent un caractère insensé parce que l’avenir suspend notre compréhension, nos capacités de lecture et de reconnaissance, même s’il ressemble encore au monde que nous connaissons. Un matin nous nous réveillons, nous allons à la cuisine, prenons une douche, nous nous habillons, chaque acte que nous effectuons de façon mécanique quotidiennement. Pourtant, cette fois-ci, nous sommes persuadés que quelque chose ne va pas, car malgré la ressemblance, le lit, la cafetière, le lavabo, les vêtements, cette chevelure encore assoupie, ne sont plus les mêmes que la veille. Un sentiment d’irréalité nous saisit, comme si tout était factice et était mal fait, pâteux, inconsistant. La réalité n’est plus alors sous notre emprise.
Directrice éditoriale — linda morren
Direction artistique — ambre lala
Conseiller & supervision artistique — paul thévenet
Textes et interviews — jean-marc thévenet pour art events
Dialogues 2018-2023 — gaël charbau et grégory chatonsky
Images et fictions textuelles — grégory chatonsky
Relecture et correction — fabienne attali & florence rech
Traduction — fabienne attal
