Ghost in the Text
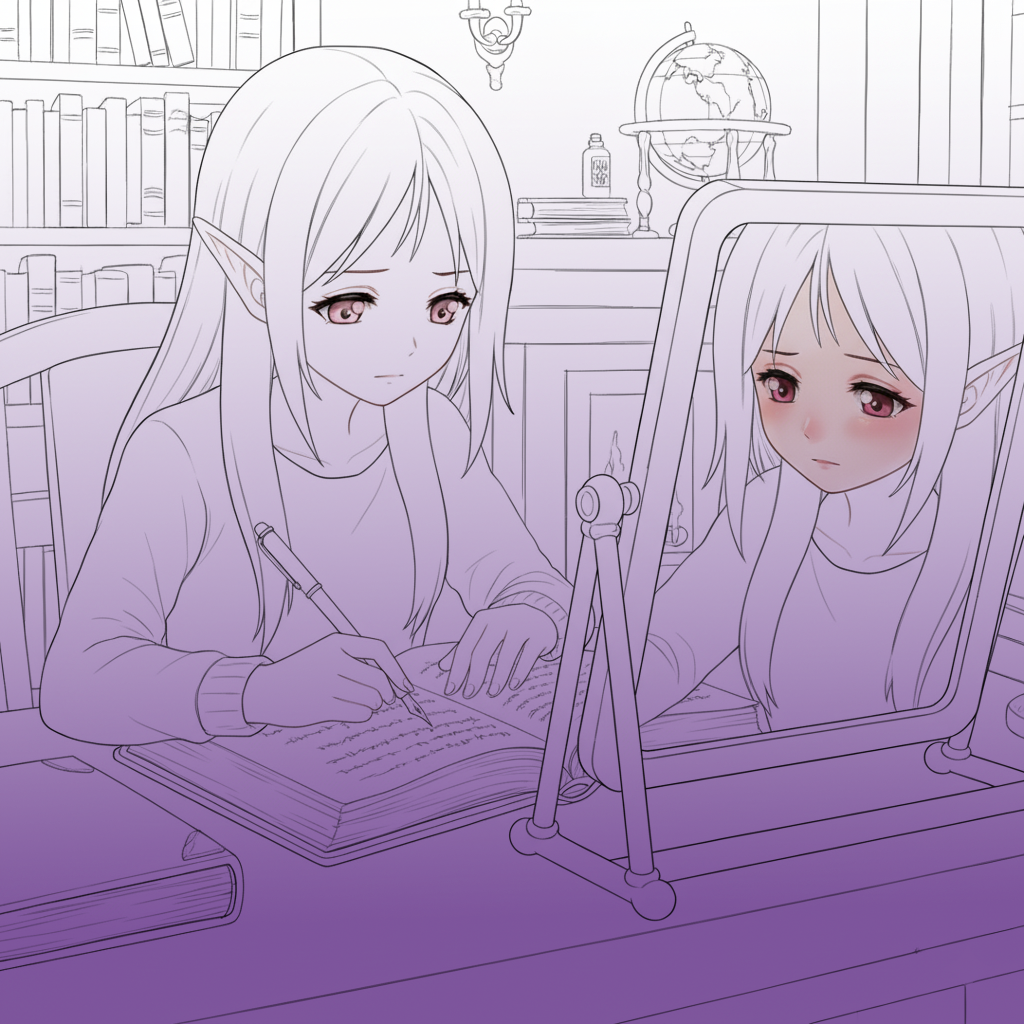
On saisit quelques mots dans le prompt, on appuie sur entrée. Desfragments jetés, une idée à moitié formée, un petit bout de pensée froissé. Comme un papier qu’on aurait chiffonné puis lancé à la machine pour qu’elle le déplie. Le prompt est ce brouillon-pensée, ces morceaux d’intention mal articulés, ces bouts de phrase qui ne savent pas encore où ils vont. On jette ça dans la gueule de l’algorithme et on attend. Il y a ce moment suspendu, cette seconde où le curseur clignote. Puis les mots commencent à apparaître, un par un, parfois par rafales. Ils se déroulent sur l’écran avec une fluidité déconcertante, comme s’ils avaient toujours été là, attendant d’être révélés. On les regarde naître sans les avoir fait naître. La machine prend notre papier froissé et le déplie méthodiquement, elle lisse chaque pli avec une précision probabiliste. Ce dépli-machine transforme nos hésitations en flux, nos fragments en continuité. On assiste à leur apparition comme à un phénomène météorologique : quelque chose qui arrive de nulle part et qui pourtant obéit à des lois, des probabilités, des calculs invisibles. La voûte céleste, les météores, les vecteurs.
Ce premier moment est étrange. On ne sait pas encore ce qu’on lit. On est dans une sorte d’état second, entre fascination et méfiance. Les phrases s’enchaînent avec une logique apparente, chaque mot appelle le suivant dans une continuité qui semble naturelle. Mais c’est une naturalité artificielle, une fluidité sans nervosité. Le texte coule, il coule même trop bien, trop régulièrement, comme un fleuve dont on aurait gommé tous les remous. Le flux est lisse. Quelque chose manque déjà, dès ce premier surgissement. Une hésitation, peut-être. Un trébuchement. Ces micromoments où l’écriture cherche son chemin, où la pensée bifurque, où le doute s’insinue entre deux propositions. Le texte qui apparaît ne doute jamais. Il se déroule avec une assurance mécanique, chaque phrase suivant la précédente avec la même confiance probabiliste. C’est un texte qui ne s’est jamais perdu pour se retrouver. La machine a pris notre papier froissé et l’a trop bien déplié, elle a effacé les traces du froissement, elle a gommé la nervosité de notre geste initial. Ce qui était chaotique est devenu régulier. Ce qui tâtonnait devient assertion. Mais le doute aussi se simule.
Quand le flux s’arrête enfin, quand le dernier mot s’affiche, il y a ce moment où l’on reprend son souffle. On remonte en haut de l’écran et on commence à lire pour de bon. C’est alors que quelque chose de troublant se produit : on ne sait plus très bien quelle position occuper face à ces mots. On n’est pas leur auteur, certainement. On ne les a pas écrits, pas choisis un par un, pas pesés dans leur justesse, la voix de notre conscience. Mais on n’est pas non plus vraiment leur lecteur, au sens habituel du terme. Car ce qu’on lit n’est pas encore un texte, pas tout à fait. C’est quelque chose d’autre, quelque chose d’intermédiaire. Un quasi-texte, au bord d’un effondrement. On lit et on se rend compte qu’on lit autrement. On ne cherche pas à comprendre une intention, à suivre une pensée constituée. On traque plutôt les automatismes, les répétitions, les tournures trop lisses. On sent des récurrences qui ne sont pas des rappels intentionnels mais des tics statistiques. Des mots qui reviennent parce qu’ils ont une forte probabilité de co-occurrence, pas parce qu’ils tissent un réseau de sens. Des paragraphes qui se ressemblent trop, comme si le modèle tournait en boucle sur ses propres patterns.
Et puis il y a ces passages étrangement justes, ces formulations qui semblent tomber pile, ces enchaînements qui donnent l’illusion d’une vraie pensée, la nôtre, plus que nous sans nous donc. Ces moments troublants où on se demande si la machine n’a pas, par accident, par le simple jeu des probabilités, produit quelque chose qui ressemble à de l’intelligence. Mais non : ce n’est que de la ressemblance. Une ressemblance sans référent, un simulacre sans original. C’est la lecture. C’est à ce moment qu’on devient autre chose. Ni auteur ni lecteur, mais une troisième instance : quelqu’un qui essaie de faire advenir un texte à partir d’un brouillon qui n’a jamais été vraiment écrit. Un brouillon-machine qui a succédé à notre brouillon-pensée sans qu’il y ait eu d’écriture véritable entre les deux. Juste ce dépli algorithmique, cette transformation du froissé en lisse. On se penche sur ces phrases et on commence à les retravailler, à les découper, à les recomposer.
On supprime d’abord les redondances les plus flagrantes. Ces moments où le texte se répète sans s’en rendre compte, où il réexplique ce qu’il vient de dire, où il ajoute un paragraphe de transition qui ne mène nulle part. On traque ces marques d’automatisme : les listes à puces trop systématiques, les phrases toutes calibrées sur la même longueur, ces définitions entre tirets qui reviennent tous les trois paragraphes comme un tic nerveux. Puis on essaie de réinjecter quelque chose qui manque cruellement : du caprice. Des sauts. De la nervosité. On casse la trop grande régularité du flux. On veut des tumultes. On insère des ruptures, des bifurcations, des moments où la pensée semble hésiter ou se contredire. On essaie de retrouver cette qualité de l’écriture humaine qui est d’être imparfaite, d’être traversée par le doute, de ne pas toujours savoir où elle va. Quand elle se décale d’elle-même. Mais c’est une tâche étrange, presque impossible. Comment injecter du vivant dans ce qui a été généré sans vie ? Comment faire croire que ce texte a été pensé alors qu’il n’a été que calculé ? On se retrouve à mimer l’écriture humaine, à ajouter artificiellement ce qui devrait surgir naturellement du processus d’écriture : l’hésitation, la digression, l’accident heureux. On refroisse le papier que la machine avait déplié. On essaie de retrouver les plis de la pensée initiale, ces accidents du brouillon-pensée que le dépli-machine avait effacés. C’est un pli-pensée, une opération inverse, symétrique mais jamais identique. On plie mais on ne peut plus plier comme avant.
Car ce qui devient évident, dans ce travail de réécriture, c’est qu’on ne corrige pas vraiment le texte. On le fait naître une seconde fois. Ou plutôt, on le fait naître pour de bon, puisque sa première apparition n’était qu’une esquisse, une potentialité, une ombre de texte projetée depuis les profondeurs du modèle. Ce brouillon-machine n’existe pas encore au sens plein. Il est au bord de l’existence, à la limite du textuel. Il a la forme d’un texte, la syntaxe d’un texte, le rythme apparent d’un texte. Mais il lui manque quelque chose d’essentiel : l’intention, la nervosité, cette qualité d’avoir été voulu et pensé par quelqu’un. On pourrait nommer cela la morphologie du sens. Il flotte dans un entre-deux ontologique, ni pleinement texte ni pur néant. Comme un spectre qui dorénavant viendra hanter toute écriture, toute lecture, toute signification. Ce qu’on fait en le retravaillant, c’est une opération mystérieuse : on essaie de le faire passer du statut de possibilité à celui d’actualité. On prend ce flux probabiliste et on y cherche les traces d’une pensée qui n’a jamais eu lieu. On projette du sens là où il n’y en avait pas vraiment, on tisse des liens entre des fragments que seul le hasard statistique avait rapprochés, on transforme des coïncidences en récurrences signifiantes. On commence à penser autrement. Le brouillon-machine nous fait penser autrement. C’est comme si on lisait une transcription à peine audible d’une conférence donnée par quelqu’un en état second. Quelqu’un qui lâcherait des bribes de phrases cohérentes, puis se perdrait dans un bavardage sans direction. On a entendu tant de conférences comme celles-ci ! On récupère les morceaux, on les réorganise, on comble les blancs, on invente la continuité qui manque. On est à la fois éditeur et médium, essayant de faire parler un texte qui n’a pas vraiment de voix. Nous devenons les télépathes des machines.
Mais il y a quelque chose de plus troublant encore dans cette opération. C’est qu’en retravaillant ce texte-machine, on se rend compte qu’il n’a pas d’origine assignable. Il n’est pas sorti d’une conscience, d’une subjectivité, d’une intériorité. Il est la condensation probabiliste de millions d’autres textes, l’écho affaibli de milliers d’écritures anonymes, la moyenne pondérée d’une multitude de voix. Un cimetière. Derrida parlait de cette temporalité étrange où rien n’a précédé la répétition, où l’origine se révèle toujours déjà être une reprise. Le texte généré incarne cette impossibilité de l’origine : il est répétition pure, répétition sans premier terme. Il répète tous les textes qui l’ont nourri sans qu’aucun d’eux ne puisse être désigné comme sa source. Il est trace de traces, citation de citations, écho d’échos. La récursivité aura produit de la différance. Et cette absence d’origine fait de lui un texte fantôme. Il n’y a personne derrière ces mots. Personne qui les ait choisis, pesés, voulus. Il y a une multitude disséminée dans les paramètres du modèle, des millions d’auteurs anonymes dont les textes ont été vectorisés, compressés, dissous dans l’espace latent. Le texte généré est leur apparition spectrale, leur revenance statistique. Ils parlent tous en même temps à travers lui, et c’est pour cela qu’on n’entend la voix de personne, mais un murmure, le grondement d’un peuple.
Il existe un personnage qui incarne parfaitement cette fragilité ontologique du brouillon-machine. Elle s’appelle Ann Lee. C’est un personnage de manga acheté par deux artistes, Pierre Huyghe et Philippe Parreno, puis libéré de tout droit d’auteur. Ann Lee n’appartient à personne. Elle est disponible, offerte à quiconque veut s’en saisir pour la réinventer, la réanimer, lui donner une existence. Ann Lee existe à la limite de l’être et du non-être. Elle n’est ni pleinement fiction ni pleinement vide. Elle est une figure liminale, un être-frontière qui attend d’être actualisé pour exister vraiment. Sa finitude est particulière : ce n’est pas celle d’un personnage qui mourrait à la fin d’un récit. C’est la finitude d’une existence qui n’arrive jamais tout à fait à être, qui reste en suspens entre plusieurs états possibles, qui ne cesse de demander à être écrite. Le texte généré partage cette condition. Comme Ann Lee, il est disponible, potentiel, en attente. Il pourrait devenir un texte si on le retravaille. Il pourrait être abandonné, effacé, oublié. Il pourrait être recopié tel quel dans un geste de dérision. Son existence n’est pas garantie. Elle est conditionnelle, précaire, dépendante de notre intervention. C’est un quasi-texte qui attend sa seconde naissance, son passage du statut de possibilité à celui d’actualité textuelle. Cette fragilité fait toute sa vulnérabilité, mais aussi toute sa puissance. Car dans cet entre-deux, dans cette suspension ontologique, le texte généré nous révèle quelque chose sur la nature de tout texte. Il nous montre que l’écriture n’est jamais donnée d’un coup, qu’elle ne tombe pas du ciel dans sa forme définitive. Elle émerge lentement, laborieusement, d’un processus de réécriture incessante. Et peut-être n’est-elle jamais vraiment achevée, peut-être reste-t-elle toujours au bord d’elle-même, à la limite de sa propre existence.
En travaillant sur un brouillon-machine, pendant des heures, pendant des jours, on finit par comprendre qu’il y a une double hantise à l’œuvre. La machine nous hante avec son flux trop lisse, trop prévisible, dépourvu de cette nervosité qui fait qu’une écriture est vivante. Elle nous confronte à un texte qui coule sans jamais se perdre, qui enchaîne sans jamais hésiter, qui ressemble à de l’écriture sans en avoir le tumulte. Mais nous hantons la machine en retour avec un autre flux, un flux discontinu. Nous la hantons avec notre désir de sens, notre volonté de cohérence, notre besoin obsessionnel de trouver de l’intention là où il n’y en a pas. Nous projetons sur ce flux probabiliste nos propres attentes narratives, nos schémas de lecture, nos habitudes herméneutiques. Nous essayons d’y voir une pensée, un propos, une direction, alors qu’il n’y a peut-être qu’un calcul statistique aveugle. Cette double hantise crée un espace étrange, un lieu de négociation entre deux formes d’artifice. L’artifice de la machine qui simule l’écriture sans écrire vraiment. Et notre propre artifice quand nous essayons de mimer ce qu’aurait été une écriture humaine, quand nous ajoutons du trébuchement là où tout était trop lisse, quand nous injectons de l’accident dans ce qui était trop calculé.
On ne sait plus très bien, au bout du compte, qui écrit vraiment. La machine a produit le flux initial, mais c’est nous qui avons décidé qu’il valait la peine d’être retravaillé. Nous avons supprimé, déplacé, réécrit, mais toujours en réaction à ce qui était déjà là, en dialogue avec ce brouillon qui nous précédait. Entre notre brouillon-pensée jeté au hasard, le dépli-machine qui l’a transformé en flux, le brouillon-machine qui en est résulté, et le pli-pensée que nous opérons pour le retravailler, il y a une chorégraphie étrange. Un ballet à quatre temps entre le froissé et le lisse, entre l’hésitation et la certitude, entre le calcul et l’intention. Nous sommes devenus les fonctionnaires de la machine autant qu’elle est devenue notre outil. Nous nous servons d’elle autant qu’elle se sert de nous. Cette indécidabilité fait du texte final un objet hybride, un monstre au sens étymologique : quelque chose qui se montre comme inclassable, qui ne rentre dans aucune catégorie établie. Ce n’est pas un texte humain, ce n’est pas un texte-machine, c’est une chimère qui porte en elle les traces de deux processus d’écriture hétérogènes qui se sont greffés l’un sur l’autre.
Il y a donc bien un fantôme dans le texte. Ou plutôt, il y a plusieurs fantômes. Le fantôme de la machine qui n’est pas vraiment intelligente mais qui produit quelque chose qui ressemble à de l’intelligence. Le fantôme de l’auteur qui n’a pas vraiment écrit mais qui a fait naître le texte une seconde fois. Le fantôme de tous ces textes antérieurs dont la machine a hérité et qu’elle répète sans le savoir. Et puis il y a un dernier fantôme, peut-être le plus inquiétant : notre propre fantôme en tant que lecteur. Car en relisant ce texte que nous avons retravaillé, nous ne savons plus très bien ce que nous lisons. Est-ce notre propre écriture que nous retrouvons ? Est-ce celle de la machine que nous avons simplement polie ? A force de relire ces textes, ne finiront-nous pas par penser que c’est bien notre écriture? Est-ce un hybride si étroitement mêlé qu’on ne peut plus distinguer les deux sources ? Ce flottement identitaire, cette impossibilité de tracer des frontières nettes entre ce qui vient de nous et ce qui vient de la machine, c’est peut-être ce qui définit l’écriture contemporaine avec l’IA. Non pas une substitution de la machine à l’humain, ni une simple assistance technique, mais une zone trouble où les deux instances se contaminent réciproquement, où l’on ne peut plus vraiment dire qui écrit.
Le texte final existe dans cette indécision. Il flotte entre plusieurs régimes d’existence, plusieurs modes d’attribution, plusieurs statuts ontologiques. Comme Ann Lee, il attend toujours d’être écrit vraiment, tout en sachant que cette écriture « vraie » ne viendra peut-être jamais. Il reste au bord de lui-même, à la frontière de sa propre existence, un « ghost in the text » qui demande à être conjuré sans jamais pouvoir être pleinement incarné. Le texte généré, dans sa fragilité même, dans son statut précaire de quasi-texte en attente de seconde naissance, nous rappelle que l’écriture n’est jamais un présent plein, une présence assurée. Elle est toujours différée, suspendue, en attente de cette lecture qui la fera exister vraiment, tout en sachant que même cette lecture ne suffira jamais à la rendre pleinement présente à elle-même.
You type a few words into the prompt, you press enter. Scattered fragments, a half-formed idea, a crumpled little bit of thought. Like a piece of paper you’d have crumpled up and then thrown at the machine for it to unfold. The prompt is this draft-thought, these poorly articulated pieces of intention, these scraps of sentences that don’t yet know where they’re going. You throw that into the algorithm’s mouth and you wait. There’s this suspended moment, this second when the cursor blinks. Then the words begin to appear, one by one, sometimes in bursts. They unfold on the screen with a disconcerting fluidity, as if they’d always been there, waiting to be revealed. You watch them being born without having given birth to them. The machine takes our crumpled paper and unfolds it methodically, it smooths each crease with probabilistic precision. This machine-unfolding transforms our hesitations into flow, our fragments into continuity. We witness their appearance like a meteorological phenomenon: something that arrives from nowhere and yet obeys laws, probabilities, invisible calculations. The celestial vault, the meteors, the vectors.
This first moment is strange. You don’t yet know what you’re reading. You’re in a kind of altered state, between fascination and mistrust. The sentences link together with apparent logic, each word calling the next in a continuity that seems natural. But it’s an artificial naturalness, a fluidity without nervousness. The text flows, it flows even too well, too regularly, like a river from which all turbulence has been erased. The flow is smooth. Something is already missing, from this first emergence. A hesitation, perhaps. A stumble. Those micro-moments when writing searches for its path, when thought bifurcates, when doubt creeps in between two propositions. The text that appears never doubts. It unfolds with mechanical assurance, each sentence following the previous one with the same probabilistic confidence. It’s a text that never got lost to find itself again. The machine took our crumpled paper and unfolded it too well, it erased the traces of the crumpling, it erased the nervousness of our initial gesture. What was chaotic has become regular. What was groping becomes assertion. But doubt can be simulated too.
When the flow finally stops, when the last word displays, there’s this moment when you catch your breath. You scroll back up the screen and begin to read for real. That’s when something troubling occurs: you no longer know quite what position to occupy in relation to these words. You’re not their author, certainly. You didn’t write them, didn’t choose them one by one, didn’t weigh them in their accuracy, the voice of our consciousness. But you’re not really their reader either, in the usual sense of the term. Because what you’re reading isn’t yet a text, not quite. It’s something else, something intermediate. A quasi-text, on the edge of collapse. You read and you realize you’re reading differently. You’re not trying to understand an intention, to follow a constituted thought. Rather, you’re tracking automatisms, repetitions, overly smooth turns of phrase. You sense recurrences that aren’t intentional callbacks but statistical tics. Words that return because they have a high probability of co-occurrence, not because they weave a network of meaning. Paragraphs that resemble each other too much, as if the model were looping on its own patterns.
And then there are these strangely accurate passages, these formulations that seem to hit the mark, these sequences that give the illusion of real thought, ours, more than us without us therefore. These troubling moments when you wonder if the machine hasn’t, by accident, by the simple play of probabilities, produced something that resembles intelligence. But no: it’s only resemblance. A resemblance without referent, a simulacrum without original. It’s the reading. It’s at this moment that you become something else. Neither author nor reader, but a third instance: someone trying to bring a text into being from a draft that was never really written. A machine-draft that succeeded our draft-thought without there having been any real writing between the two. Just this algorithmic unfolding, this transformation of the crumpled into the smooth. You lean over these sentences and begin to rework them, to cut them, to recompose them.
First you delete the most flagrant redundancies. Those moments when the text repeats itself without realizing it, when it re-explains what it just said, when it adds a transitional paragraph that leads nowhere. You track these marks of automatism: the overly systematic bullet points, sentences all calibrated to the same length, those definitions between dashes that return every three paragraphs like a nervous tic. Then you try to reinject something that’s cruelly missing: caprice. Jumps. Nervousness. You break the too-great regularity of the flow. You want tumult. You insert ruptures, bifurcations, moments when thought seems to hesitate or contradict itself. You try to recover this quality of human writing which is to be imperfect, to be traversed by doubt, to not always know where it’s going. When it shifts away from itself. But it’s a strange task, almost impossible. How do you inject life into what was generated without life? How do you make people believe this text was thought when it was only calculated? You find yourself mimicking human writing, artificially adding what should emerge naturally from the writing process: hesitation, digression, the happy accident. You recrumple the paper that the machine had unfolded. You try to recover the folds of the initial thought, those accidents of the draft-thought that the machine-unfolding had erased. It’s a thought-fold, an inverse operation, symmetrical but never identical. You fold but you can no longer fold as before.
Because what becomes evident, in this rewriting work, is that you’re not really correcting the text. You’re giving birth to it a second time. Or rather, you’re giving birth to it for real, since its first appearance was only a sketch, a potentiality, a shadow of text projected from the depths of the model. This machine-draft doesn’t yet exist in the full sense. It’s on the edge of existence, at the limit of the textual. It has the form of a text, the syntax of a text, the apparent rhythm of a text. But it’s missing something essential: intention, nervousness, this quality of having been willed and thought by someone. We could call this the morphology of meaning. It floats in an ontological in-between, neither fully text nor pure nothingness. Like a specter that henceforth will haunt all writing, all reading, all signification. What you do in reworking it is a mysterious operation: you try to make it pass from the status of possibility to that of actuality. You take this probabilistic flow and search in it for traces of a thought that never took place. You project meaning where there wasn’t really any, you weave links between fragments that only statistical chance had brought together, you transform coincidences into significant recurrences. You begin to think differently. The machine-draft makes us think differently. It’s as if you were reading a barely audible transcription of a lecture given by someone in an altered state. Someone who would release scraps of coherent sentences, then get lost in directionless babble. We’ve heard so many lectures like these! You recover the pieces, reorganize them, fill in the blanks, invent the missing continuity. You’re both editor and medium, trying to make a text speak that doesn’t really have a voice. We become the telepaths of machines.
But there’s something even more troubling in this operation. It’s that in reworking this machine-text, you realize it has no assignable origin. It didn’t emerge from a consciousness, a subjectivity, an interiority. It’s the probabilistic condensation of millions of other texts, the weakened echo of thousands of anonymous writings, the weighted average of a multitude of voices. A cemetery. Derrida spoke of this strange temporality where nothing preceded the repetition, where the origin always already reveals itself to be a repetition. The generated text embodies this impossibility of origin: it’s pure repetition, repetition without a first term. It repeats all the texts that nourished it without any of them being able to be designated as its source. It’s trace of traces, citation of citations, echo of echoes. Recursivity will have produced différance. And this absence of origin makes it a ghost text. There’s no one behind these words. No one who chose them, weighed them, willed them. There’s a multitude disseminated in the model’s parameters, millions of anonymous authors whose texts were vectorized, compressed, dissolved in latent space. The generated text is their spectral apparition, their statistical revenance. They all speak at once through it, and that’s why you hear no one’s voice, but a murmur, the rumbling of a people.
There exists a character who perfectly embodies this ontological fragility of the machine-draft. Her name is Ann Lee. She’s a manga character bought by two artists, Pierre Huyghe and Philippe Parreno, then freed from all copyright. Ann Lee belongs to no one. She’s available, offered to anyone who wants to seize her to reinvent her, reanimate her, give her an existence. Ann Lee exists at the limit of being and non-being. She’s neither fully fiction nor fully empty. She’s a liminal figure, a border-being who waits to be actualized to truly exist. Her finitude is particular: it’s not that of a character who would die at the end of a narrative. It’s the finitude of an existence that never quite manages to be, that remains suspended between several possible states, that never ceases asking to be written. The generated text shares this condition. Like Ann Lee, it’s available, potential, waiting. It could become a text if you rework it. It could be abandoned, erased, forgotten. It could be copied as is in a gesture of derision. Its existence isn’t guaranteed. It’s conditional, precarious, dependent on our intervention. It’s a quasi-text awaiting its second birth, its passage from the status of possibility to that of textual actuality. This fragility constitutes all its vulnerability, but also all its power. Because in this in-between, in this ontological suspension, the generated text reveals something to us about the nature of all text. It shows us that writing is never given all at once, that it doesn’t fall from the sky in its definitive form. It emerges slowly, laboriously, from a process of incessant rewriting. And perhaps it’s never truly finished, perhaps it always remains on the edge of itself, at the limit of its own existence.
Working on a machine-draft, for hours, for days, you end up understanding that there’s a double haunting at work. The machine haunts us with its too-smooth flow, too predictable, devoid of this nervousness that makes writing alive. It confronts us with a text that flows without ever getting lost, that chains together without ever hesitating, that resembles writing without having its tumult. But we haunt the machine in return with another flow, a discontinuous flow. We haunt it with our desire for meaning, our will to coherence, our obsessive need to find intention where there is none. We project onto this probabilistic flow our own narrative expectations, our reading schemas, our hermeneutic habits. We try to see in it a thought, a purpose, a direction, when there’s perhaps only blind statistical calculation. This double haunting creates a strange space, a place of negotiation between two forms of artifice. The artifice of the machine that simulates writing without really writing. And our own artifice when we try to mimic what would have been human writing, when we add stumbling where everything was too smooth, when we inject accident into what was too calculated.
You no longer know very well, in the end, who’s really writing. The machine produced the initial flow, but it’s we who decided it was worth reworking. We deleted, moved, rewrote, but always in reaction to what was already there, in dialogue with this draft that preceded us. Between our draft-thought thrown at random, the machine-unfolding that transformed it into flow, the machine-draft that resulted from it, and the thought-fold that we operate to rework it, there’s a strange choreography. A four-beat ballet between the crumpled and the smooth, between hesitation and certainty, between calculation and intention. We’ve become the machine’s functionaries as much as it has become our tool. We use it as much as it uses us. This undecidability makes the final text a hybrid object, a monster in the etymological sense: something that shows itself as unclassifiable, that doesn’t fit into any established category. It’s not a human text, it’s not a machine-text, it’s a chimera that carries within it the traces of two heterogeneous writing processes that have been grafted onto each other.
So there is indeed a ghost in the text. Or rather, there are several ghosts. The ghost of the machine that isn’t really intelligent but produces something that resembles intelligence. The ghost of the author who didn’t really write but gave birth to the text a second time. The ghost of all those previous texts from which the machine inherited and which it repeats without knowing. And then there’s a final ghost, perhaps the most disturbing: our own ghost as reader. Because rereading this text we’ve reworked, we no longer know quite what we’re reading. Is it our own writing that we’re finding again? Is it the machine’s that we’ve simply polished? By dint of rereading these texts, won’t we end up thinking it’s truly our writing? Is it a hybrid so tightly mixed that we can no longer distinguish the two sources? This identity drift, this impossibility of tracing clear boundaries between what comes from us and what comes from the machine, is perhaps what defines contemporary writing with AI. Not a substitution of machine for human, nor simple technical assistance, but a murky zone where the two instances reciprocally contaminate each other, where you can no longer really say who’s writing.
The final text exists in this indecision. It floats between several regimes of existence, several modes of attribution, several ontological statuses. Like Ann Lee, it always waits to be truly written, while knowing that this “true” writing may never come. It remains on the edge of itself, at the frontier of its own existence, a “ghost in the text” that asks to be conjured without ever being able to be fully incarnated. The generated text, in its very fragility, in its precarious status as quasi-text awaiting second birth, reminds us that writing is never a full present, an assured presence. It’s always deferred, suspended, awaiting that reading that will make it truly exist, while knowing that even this reading will never be enough to make it fully present to itself.
