Surproductions de l’imagination logicielle et humaine
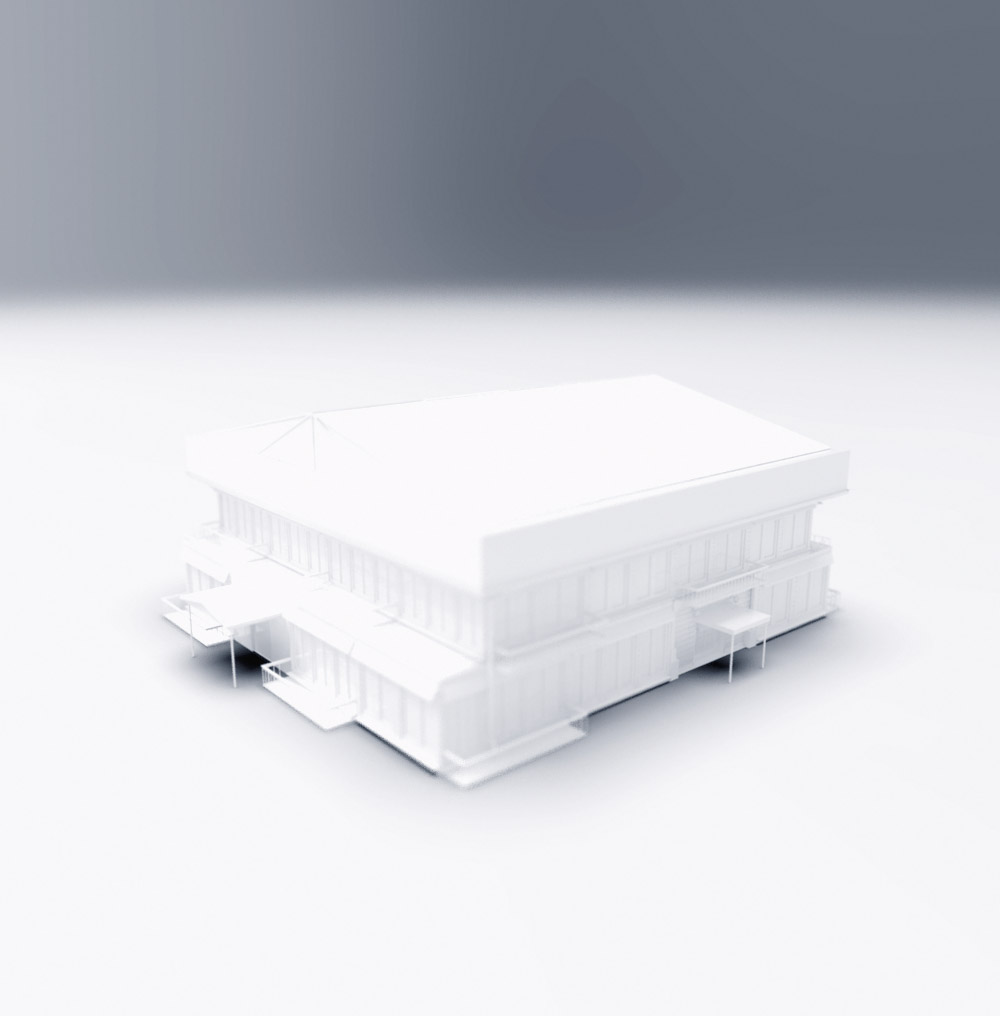
En vue de produire une très grande quantité de documents en continu, il existe au moins deux stratégies dont la complémentarité est révélatrice de notre époque.
D’une part, la génération logicielle permet de produire une quasi-infinité de médias (texte, musique et image). La difficulté consiste souvent, lorsqu’on souhaite dépasser l’approche formaliste abstraite (nuées de pixels et autres lieux communs de ce qui s’est appelé à une époque l’art numérique), à parvenir à modéliser un résultat convaincant. Il s’agit en quelque sorte d’un test de Turing culturel : en voyant le résultat, sans en connaître la provenance, estimons-nous qu’il appartient à une série préexistante, c’est-à-dire la machine est-elle capable de nous tromper et de produire un résultat crédible ?
Cette question du réalisme généré par machine nous confronte à une aporie fondamentale : la crédibilité devient le critère principal d’évaluation, supplantant l’originalité ou l’expressivité qui caractérisaient traditionnellement l’esthétique. L’horizion d’attente n’est plus la création ex nihilo mais la simulation convaincante. La machine doit produire des œuvres qui s’insèrent sans friction dans nos catégories préexistantes, qui s’intègrent silencieusement dans nos séries culturelles déjà constituées. Le paradoxe est saisissant : l’innovation technologique majeure qu’est la génération automatisée se trouve évaluée à l’aune de sa capacité à dissimuler sa nouveauté même, à faire comme si elle n’était pas.
Cette difficulté varie selon les médiums, le texte étant par exemple plus aisé à modéliser qu’une musique pop comme dans le cas de Capture. Le caractère convaincant de ces productions est une problématique esthétique complexe : cette musique est-elle expérimentale ou ressemble-t-elle à quelque chose de connue ? Ce texte est-il lisible ? À chaque fois, le type de modélisation dépend de la construction d’une reconnaissance et de la relation entre la définition du monde et le langage. On pourrait parler de réalisme culturel dont le critère serait de pouvoir faire entrer dans une série culturelle préexistante, un exemplaire produit par une machine. Il y a dans ce réalisme quelque chose de conventionnel qui ramène quelque chose à du déjà connu.
Cette notion de réalisme culturel déplace subtilement le champ de la mimesis : il ne s’agit plus d’imiter la nature ou le réel, mais d’imiter nos constructions culturelles elles-mêmes, de produire des signes qui renvoient à d’autres signes déjà validés. La machine est jugée réussie non pas lorsqu’elle invente véritablement, mais lorsqu’elle reproduit les patterns, les structures, les formes que nous avons déjà appris à reconnaître comme signifiantes. Cette circularité sémiotique, où les signes ne renvoient qu’à d’autres signes dans une chaîne sans origine ni fin, constitue peut-être la caractéristique essentielle de notre régime esthétique contemporain.
D’autre part, le réseau permet d’avoir accès à une quantité inimaginable de données produites par des êtres humains. Ces données sont décontextualisées et peuvent être reprises, articulées, réagencées selon un contexte de création. Il s’agit d’une surproduction humaine que je nomme l’hyperproduction des anonymes et dont le nom courant est “big data”. Elle est aussi en nombre quasi-infini, dans la mesure où elle grandit plus vite que notre capacité à la parcourir, ne cessant de se renouveler.
Cette hyperproduction des anonymes constitue le versant anthropologique de notre excès contemporain. Ces traces numériques innombrables, ces émissions continues de signes par des millions d’êtres humains connectés forment un océan de données qui déborde irrémédiablement notre capacité d’appréhension. Chaque minute, des milliers d’heures de vidéo sont mises en ligne, des millions de messages sont échangés, d’innombrables images sont partagées – flux incessant qui rend caduque toute ambition d’exhaustivité, toute prétention à une vision synoptique.
On peut bien sûr tenter d’extraire des informations utilisables dans ce flux de big data. On peut également s’attacher à la singulière émotivité de toutes ces données, au trouble de leur anonymat pourtant si intime qui est tel un grondement de nos imaginaires et de nos existences. Le darknet, ces données qui ne renvoient à rien et que rien ne vient renvoyer, constitue également une émotion particulière au réseau : la solitude des données qui persistent à être sans pourtant être consultées.
Cette perspective sensible sur les données massives introduit une dimension poétique dans ce qui semblait n’être qu’un enjeu technique. L’anonymat paradoxalement intime de ces traces numériques, leur capacité à incarner nos existences tout en les dissolvant dans un flux indifférencié, crée une tension émotive propre à notre condition contemporaine. Plus troublante encore est cette évocation du darknet comme lieu d’une solitude ontologique des données – fragments d’existence numérique condamnés à persister sans jamais être actualisés par un regard, présences spectrales qui hantent les marges invisibles du réseau.
Il n’y a pas d’opposition entre ces deux types de surproductions, mais plutôt un écho étrange qui maintient l’écart entre le technologique et l’anthropologique. Les deux sont en effet partie prenante dans l’univers du consumérisme, les machines pour produire, les êtres humains pour consommer, dans un mouvement incessant de boucle de l’offre et de la demande qui est devenu la loi du désir et de la servitude.
Ce parallélisme entre l’hyperproduction logicielle et l’hyperproduction humaine dessine une économie libidinale particulière à notre époque. Les deux régimes ne s’opposent pas frontalement mais se répondent, se complètent, s’alimentent mutuellement dans une chorégraphie complexe. Leur séparation même – ces deux lignes qui se suivent sans jamais se confondre – devient productive, génératrice de tensions créatives, d’articulations inédites entre le calculable et l’incalculable, entre l’algorithme et l’affect.
On peut avancer l’hypothèse d’une convergence entre ces deux hyperproductions. Nous pourrions utiliser les données massives accumulées sur le réseau afin de produire des résultats qui sans être identiques aux données déjà existantes pourraient appartenir vraisemblablement à la même série. Cela supposerait que la machine “apprenne” à prolonger une base de données au-delà de ses limites. L’intelligence artificielle non-directionnelle, ou machine learning, pourrait peut-être être une voie plus intéressante que la génération morphologique (qui suppose l’élaboration d’un modèle) pour l’automatisation la production culturelle, automatisation qui serait aussi celle du réalisme (mimésis).
Cette hypothèse d’une convergence ouvre vers un horizon fascinant : celui d’une machine qui n’apprendrait plus à partir de modèles abstraits élaborés par des ingénieurs, mais directement à partir des traces laissées par l’activité humaine sur le réseau. Ce n’est plus seulement la morphologie d’un genre musical ou littéraire qu’elle apprendrait à reproduire, mais les patterns cachés, les structures implicites, les régularités invisibles qui organisent notre production culturelle commune. L’intelligence artificielle deviendrait ainsi une sorte de miroir actif, capable non seulement de refléter nos créations mais de les prolonger, de les amplifier, d’en révéler des potentialités inexplorées.
Relier ainsi l’hyperproduction des anonymes à la génération logicielle donnerait non seulement une signification rétrospective au Web 2.0 et au mot d’ordre de l’accumulation des données, mais, pour l’artiste, permettrait d’articuler encore plus profondément le technologique et l’anthropologique sur le plan, non plus seulement fonctionnel, mais imaginaire. Ne faudrait-il pas alors remplacer le concept d’intelligence artificielle, avec tout ce qu’il suppose de privilège accordé à la rationnalité, par celui d’imagination artificielle ? Celle-ci serait à entendre comme la capacité des logiciels à imaginer et comme notre faculté à nous projeter imaginairement dans ces résultats.
Cette proposition finale de substituer l’imagination artificielle à l’intelligence artificielle constitue peut-être le geste conceptuel le plus audacieux. Elle suggère un déplacement radical du paradigme dominant : plutôt que de chercher à reproduire nos facultés rationnelles, nos capacités de calcul et d’inférence, les machines pourraient tenter de simuler notre faculté la plus mystérieuse – celle d’imaginer, de créer des mondes possibles, de projeter l’inexistant. Ce déplacement impliquerait non seulement une transformation technique, mais aussi une métamorphose de notre rapport à ces machines – non plus outils de productivité ou extensions de notre raison, mais partenaires dans l’élaboration d’un imaginaire commun, co-créateurs d’un espace symbolique partagé.
L’imagination artificielle contiendrait ainsi une double dimension : d’une part, la capacité technique des algorithmes à générer de l’imprévu, à produire du nouveau à partir du déjà-là ; d’autre part, notre propre capacité à investir ces productions de sens, à y projeter nos désirs, nos craintes, nos fantasmes. C’est dans cette relation dialectique, dans cet entre-deux entre la machine qui apprend à imaginer et l’humain qui imagine à travers la machine, que pourrait se dessiner une esthétique proprement contemporaine – ni technophile ni technophobe, mais attentive aux nouvelles formes de sensibilité qui émergent de notre entrelacement croissant avec les dispositifs techniques.
